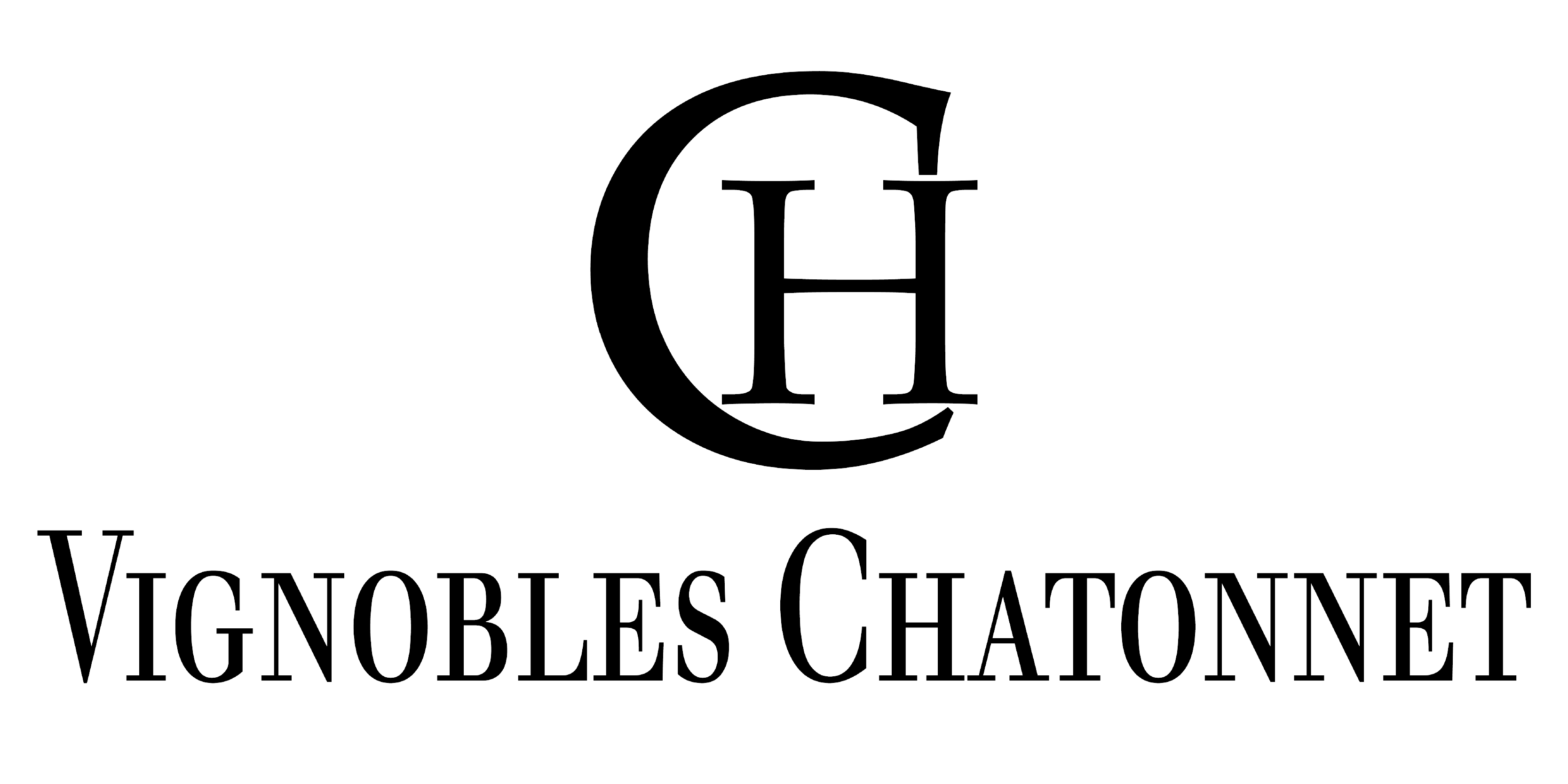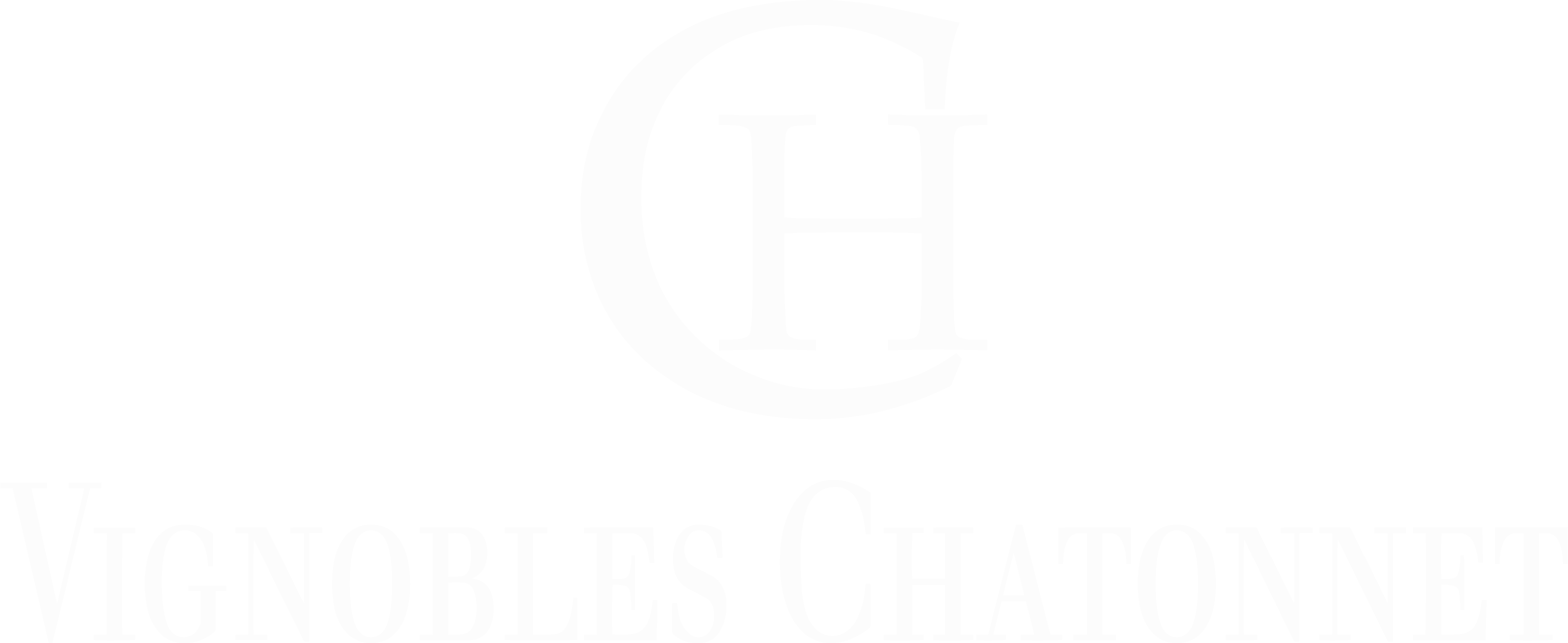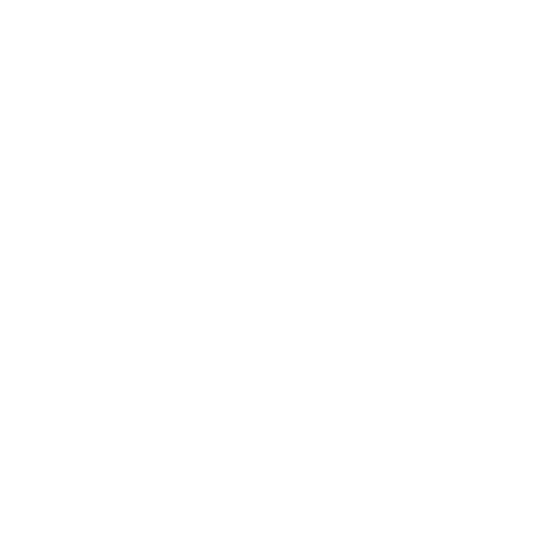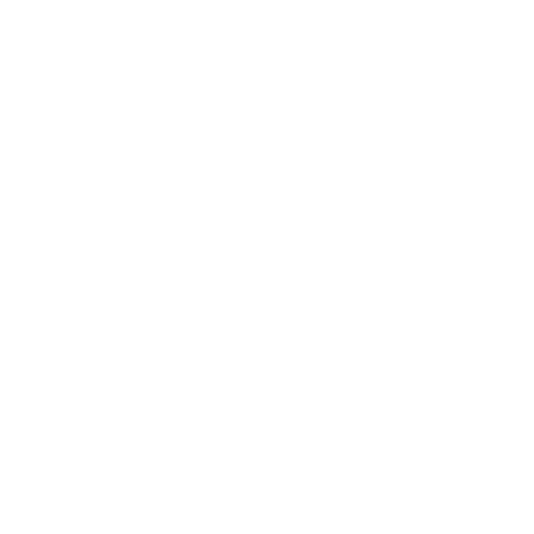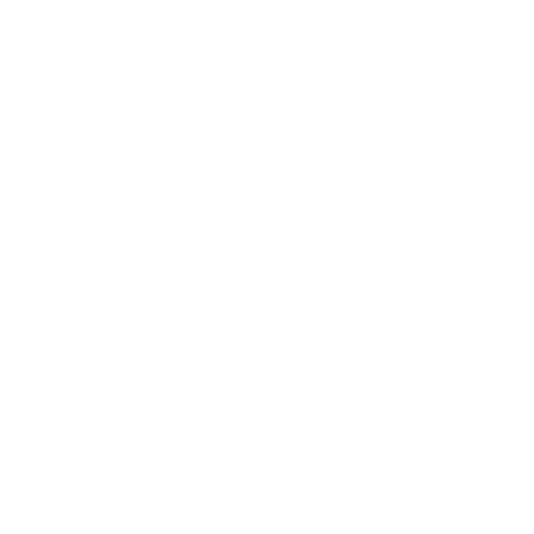Notre histoire et nos ambitions
Avec une production annuelle d’environ 150 000 bouteilles, les Vignobles Chatonnet font partie des propriétés incontournables de l’appellation Lalande de Pomerol. Nos vins sont distribués en France et à l’étranger par l’intermédiaire du négoce bordelais et d’importateurs directs.
Nos vins

LA CROIX CHAIGNEAU
Découvrir ce vin
CHÂTEAU HAUT-CHAIGNEAU
Découvrir ce vin
LA SERGUE
Découvrir ce vin
L'ARCHANGE
Découvrir ce vin
Visites et dégustations
Les Vignobles Chatonnetvous proposent un programme œnotouristique à la découverte d’un vignoble au carrefour des appellations Lalande de Pomerol, Saint Emilion et montagne Saint Emilion.


Vignobles Chatonnet
Le club
SUCCOMBEZ À VOTRE PASSION !
REJOIGNEZ NOTRE CLUB EXCLUSIF VIGNOBLES CHATONNET.

QUELLE QUE SOIT VOTRE ENVIE, NOUS AVONS UN CLUB POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS D’EXPÉRIENCES UNIQUES AU SEIN D’UN VIGNOBLE PRESTIGIEUX.

SI VOUS CHANGEZ D’AVIS, VOUS POUVEZ FACILEMENT ESSAYER QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU OU ACCÉDER AUTOMATIQUEMENT À DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES RÉSERVÉES AUX MEMBRES DES NIVEAUX SUPÉRIEURS DE NOTRE CLUB !
DécouvrirLe club
Le club "Cercle des vignerons"
Prix de vente500,00€
Le club "Terroirs"
Prix de vente1.200,00€
Le club "Jeanine et André Chatonnet"
Prix de vente1.800,00€